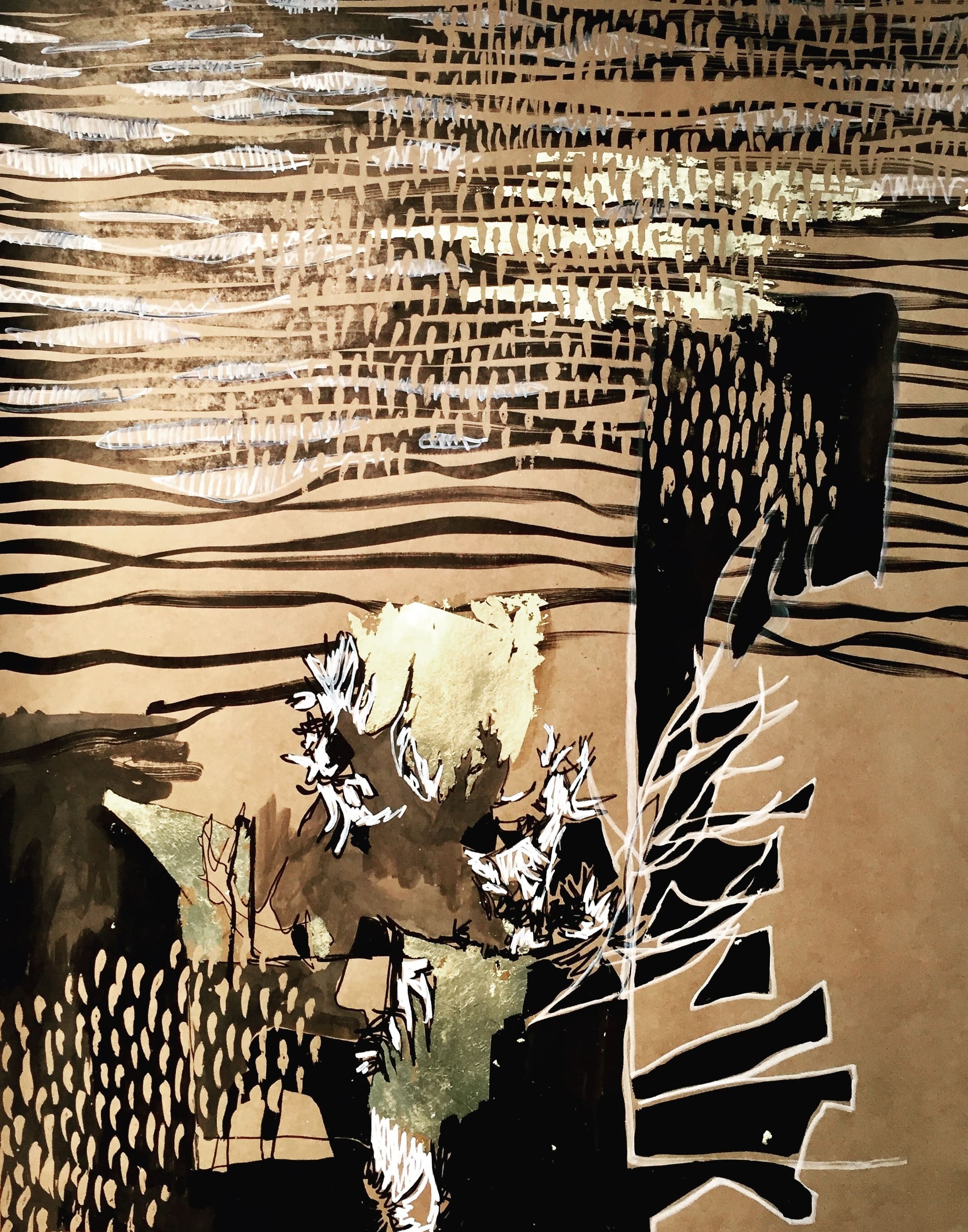12 juin. 13h00. Nous nous sommes données rendez-vous dans un café pour la préparation du texte portant sur la parentalité comme travail. Nous avons pour objectif de retravailler une présentation que Mélissa a faite dans le cadre du panel tenu à l’UQAM le 8 mars dernier portant sur le travail des femmes. Bébé Edgar, 3 mois, nous accompagne. Il fait trop chaud. Il n’a pas dormi depuis 6h00 du matin, il fait 34 degrés dehors. Il est tellement fatigué et accablé par la chaleur qu’il chigne sans cesse. On le comprend : l’une venant du Saguenay et l’autre du Bas-du-Fleuve, la chaleur, ça nous tape sur les nerfs. Pas moyen de le faire dormir dans sa poussette. Attends. On va changer de côté de table, comme ça la poussette va être plus facile à faire swigner. Échec. Pourtant nous y étions presque! Résignées, le bébé d’une main et le clavier d’ordinateur de l’autre, on essaie de trouver le fil conducteur de ce texte, de garder le focus à travers les hurlements, la suce qui tombe, on rince la suce, on la remet dans sa bouche.. Geneviève sort le sein, le bébé n’est pas intéressé. Geneviève range le sein. Oupelaye on a oublié le biberon à la maison. On va espérer ne pas en avoir besoin. Au pire, il y a un Jean-Coutu pas loin, on ira en acheter un. Est-ce que ça vaut la peine d’encore dépenser des sous ou on retourne à la maison? De quoi on parlait déjà? Ah oui. Écrire sur le travail parental à travers notre expérience.
Je crois qu’il est d’abord important d’aborder mon parcours en tant que travailleuse dans le domaine de l’intervention, puisque c’est un domaine majoritairement investi par les femmes. Je suis intervenante depuis plus de 15 ans et j’ai eu à composer avec des conditions de travail vraiment difficiles. Dans les milieux de travail de type «hébergement», les tâches à effectuer relèvent du domaine du «care» : faire le ménage, préparer les repas, donner les bains, changer les culottes d’incontinence, etc. Tout ça pour un salaire qui avoisine souvent le minimum prescrit par la loi, sans congés de maladie, avec des horaires de soir et de fin de semaine. Par exemple, une fois j’ai dû prendre congé pendant une semaine, à mes frais, parce que mon enfant était malade. Aussi, dans ce genre de ressources intermédiaires (relevant du partenariat public-privé) il n’y généralement pas beaucoup d’employé.es en «back up». Donc, quand un.e collègue tombe malade, tu es sollicité.e pour le/la remplacer, même si des fois tu viens de te taper 5-6 jours en ligne. J’ai toujours ressenti beaucoup de pression de la part de mes employeurs à me conformer à leurs exigences en termes de disponibilités, ce qui n’est vraiment pas évident quand tu as un enfant en garde partagée. J’ai constamment dû me battre pour avoir un horaire décent, en accord avec mon rôle parental.
D’ailleurs, parlons-en de la fameuse garde partagée. Je me suis déjà fait dire que je ne suis pas une vraie mono(parentale), parce qu’une semaine sur deux j’étais en «congé» d’enfant. Je tiens à souligner que garde partagée ne veut pas dire responsabilités partagées. Quand quelque chose cloche à l’école, c’est la mère qu’on appelle en premier. C’est aussi moi qui gérais le travail invisible de la remise des bulletins, des concerts de Noël, des rendez-vous médicaux, etc. Donc, même quand mon enfant n’est pas à la maison, je reste sa mère et j’ai des choses à gérer. C’est difficile de se défaire du carcan de la mère parfaite et dévouée. Mais petit à petit, j’ai fait des petites révolutions personnelles. Je me suis permis de rater des rencontres de bulletin, des concerts de Noël et j’ai délégué certaines prises de rendez-vous.
J’ai commencé mon bac en Travail social en septembre 2013. À ce moment-là, je travaillais à temps plein comme intervenante. J’avais donc pris la décision de faire mes études à temps partiel. Pendant ma première session universitaire, je suis tombée malade. Un petit rhume. Ce petit rhume avait du mal à guérir et ma santé physique s’est vraiment détériorée. Je suis allée plusieurs fois à la clinique sans rendez-vous, mais on me disait que ça passerait, que je devais boire de l’eau et me reposer. J’ai épuisé tous mes congés de maladie dans un premier temps, et ensuite, ma banque de temps accumulé. Finalement, un peu avant Noël, j’ai pris rendez-vous chez mon médecin, car j’étais vraiment au bout du rouleau. Elle m’a diagnostiqué une pneumonie et j’étais évidemment en épuisement professionnel. J’ai donc été en congé de maladie. Les premiers jours, mon médecin me menaçait de me rentrer à l’hôpital, car j’étais incapable de me reposer. J’avais tellement de choses à gérer : chômage, assurances, etc. Puis, tout au long de mon congé de maladie, j’étais vraiment «chanceuse», car mon agent d’assurances m’appelait toutes les semaines pour savoir comment j’allais. Il me demandait sur une échelle de 1 à 10 comment j’allais, puis quand je pensais retourner au travail. C’est vraiment frustrant de réaliser que, malgré que tu prennes soin des autres, au final tu n’as même pas droit de prendre un moment de répit pour te remettre sur pied et penser à toi juste un peu. Au bout de quatre mois, je suis retournée travailler. Évidemment, quelques semaines plus tard, tout était à recommencer, parce que dans le fond, rien n’avait changé, j’avais toujours les mêmes difficultés avec mon employeur au sujet de mon horaire de travail. J’ai donné ma démission peu de temps après mon retour.
J’ai décidé de me lancer à temps plein dans les études. J’avais envie de prendre une pause de ma vie de travailleuse à temps plein et m’investir uniquement dans mes études. Je pensais que ma vie d’étudiante serait vraiment plus relax. Je pensais aussi que je pourrais y arriver en nous serrant un peu la ceinture et en ayant un mode de vie plus «simple». Mais comment faire plus simple quand tu es précaire? J’ai vite déchanté. Les prêts et bourses ne me donnaient presque rien, car j’avais eu un trop gros revenu au cours de l’année précédente. Avec des sessions à temps plein, j’étais incapable de travailler assez pour subvenir à nos besoins. Puis avec les cours parfois de soir et les trop nombreux travaux d’équipe, ma vie d’étudiante n’avait rien de relax du tout. Au bout de cette année-là, j’ai failli abandonner mes études, croulant sous les factures et les dettes, mais surtout épuisée moralement. Heureusement, j’ai été embauchée au Comité de soutien aux parents étudiants de l’UQAM, ce qui m’a permis de souffler un peu financièrement (malgré que je combinais deux autres emplois «on the side» pour rattraper le retard accumulé dans mes factures).
Même si cette année-là a été plus calme, j’avais quand même un nuage gris qui planait au-dessus de ma tête. Je voyais les stages non rémunérés arriver et je me demandais comment j’allais faire pour arriver financièrement. J’ai encore une fois pensé abandonner. Heureusement, j’ai un bon réseau de soutien social et familial (fortement féminisé, avouons-le). Ma soeur et ma belle-soeur m’ont proposé d’aller vivre dans le sous-sol de leur maison à Longueuil avec mon fils. J’ai dit oui, je n’avais pas tellement d’autres options. Je me sens vraiment reconnaissante envers elles de m’avoir hébergée, mais ça n’a pas toujours été facile. Nous avons eu quelques conflits et j’ai eu peur que la relation entre elles et moi en subisse les contrecoups. Ce n’est pas évident de concilier des styles de vie différents et de partager l’intimité à quatre dans une petite maison. De plus, mon fils et moi avons été déracinés loin de notre réseau social, ce qui nous a fait vivre quelques fois un sentiment d’isolement. Je ne peux m’empêcher de penser que si j’avais eu des stages rémunérés, j’aurais pu garder mon appartement et nous n’aurions pas été obligés de vivre tout ce stress et ces chambardements. De plus, cette solution est une fausse bonne solution en soi, puisque c’est une solution individuelle qui relève de mon privilège d’avoir un réseau familial qui me supporte.
Malgré mon parcours difficile, je suis consciente d’être une personne privilégiée. Je suis blanche, je suis née au Canada, je suis une personne cisgenre, j’ai déjà un diplôme et de l’expérience de travail, j’ai un bon réseau social et familial. Malgré qu’il n’y ait pas de portrait type des parents étudiants, les personnes qui viennent demander de l’aide au CSPE-UQAM sont presque exclusivement des femmes (je vous laisse en tirer vos propres conclusions), souvent immigrantes et/ou monoparentales. Le cursus scolaire de certains parents étudiants est un vrai parcours de combattante : surendettement, non-accès à un service de garde, cours de soir, stages non rémunérés, manque de temps pour s’investir dans leurs études, difficultés liées à l’immigration, violences de toutes sortes, etc. La situation est particulièrement intense pour les étudiantes en éducation, qui doivent soutenir un rythme d’étude à temps plein et effectuer quatre stages non rémunérés au cours de leur cursus scolaire.
16h00: Trois heures plus tard, après nous être déplacées chez Geneviève un peu plus tôt dans l’espoir d’endormir le bébé et de travailler sur le texte afin de le rendre plus soutenu, nous sommes complètement épuisées. Pourtant, nous réalisons que le fil conducteur que nous cherchions depuis des heures nous pendait au bout du nez. Nous n’avons pas besoin de citer des sociologues dans ce texte pour faire valoir notre point (même si ce n’est pas l’envie qui manque; on est des parents-étudiants et on aime ça aussi la théorie!). Nos parcours, loin d’être des cas isolés, illustrent très bien notre point: notamment par le caractère gratuit et illimité, le travail parental et et le travail académique sont intimement liés et leurs systèmes d’exploitation jouent en défaveur des femmes. C’est pour ne laisser derrière aucune de ces moms qu’il faut généraliser la lutte pour la rémunération des stages et surtout ne pas la confiner à certains programmes ou niveaux d’études. Voilà, il ne nous reste qu’à bonifier le texte ici et là, entre deux biberons ou séances de devoirs. Satisfaites de ce constat, nous retournons à nos vies respectives, celles de soccer mom d’un ado et celle d’une mom d’un nourrisson, qui essaient du mieux qu’elles peuvent de militer à travers tout ça.
Mélissa Renaud en collaboration avec Geneviève Vaillancourt
* * *
Cet article a été publié dans le numéro de l’automne 2017 du CUTE Magazine.
Pour te tenir informé.e sur la lutte pour la pleine reconnaissance du travail étudiant, pour en discuter ou pour y contribuer, tu peux nous contacter via la page CUTE Campagne sur le travail étudiant.