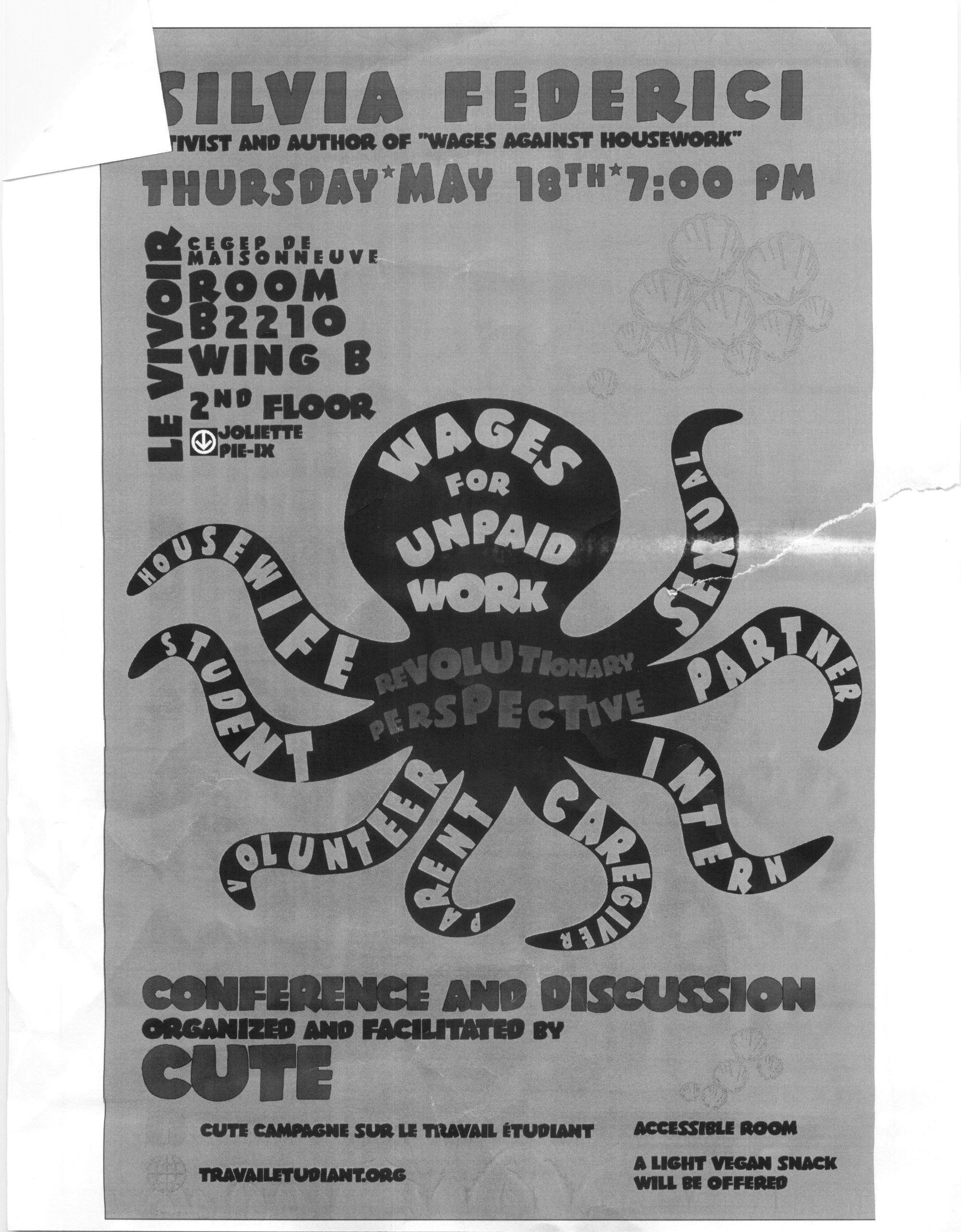Par Morgane Merteuil, militante féministe et ancienne secrétaire générale du Syndicat du travail sexuel (France)
Peu après la rentrée étudiante 2017 en France, un véhicule publicitaire stationnant près d’une université parisienne fit scandale. Faisant la promotion d’un site de rencontres du type « sugar daddy-sugar baby [1]», il fit immédiatement l’objet d’une plainte d’un syndicat étudiant[2]. S’il est toujours légitime de dénoncer ceux qui ne voient dans la précarité étudiante qu’une occasion de faire des profits, force est de constater que la stigmatisation particulière de l’industrie du sexe par rapport aux autres industries employant des étudiant.e.s n’aide en rien ces dernier.e.s. En France, entre 2004 et 2015, les jeunes entre 18 et 29 ans ont été la catégorie pour laquelle la progression du taux de pauvreté fut la plus forte (de 8 % à 12,5 %)[3], et il est permis de croire que la situation ne s’était pas améliorée au moment où le camion décrié sillonnait les quartiers étudiants de Paris.
Alors que ces taux de pauvreté chez les jeunes peuvent certainement expliquer le potentiel succès des sites de rencontres tarifées, ce contexte économique n’est pourtant pas mentionné dans la Loi française renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (2016), établissant notamment la pénalisation des client.e.s. La lutte contre la prostitution des jeunes n’y fait l’objet que d’un seul article, établissant qu’« une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires [4]». La prostitution étudiante serait ainsi causée par la seule méconnaissance de ces réalités, et non parce que la connaissance de ces « dangers » n’a souvent que peu de poids face au besoin de se loger, se nourrir, ou acheter des livres. Pour des étudiant.e.s en situation de précarité, en France comme au Québec, le travail du sexe peut en effet apparaître comme un moyen permettant de financer ses besoins quotidiens, un moyen temporaire de faire tenir ensemble les divers impératifs de la vie étudiante, jusqu’à l’obtention d’un « vrai » travail. Mais encore faut-il que ce « vrai » travail paie.
Or, comme est en train de brillamment le rappeler le mouvement pour la rémunération de tous les stages au Québec, tout travail ne paie pas. Notamment, celui exercé par les femmes en contexte de stage, ne paie pas. Il est donc permis de penser que dans ce contexte, travailleur.ses du sexe et stagiaires non-payé.e.s sont deux groupes qui, en certains endroits, n’en font qu’un. Mais alors que le travail du sexe peut apparaître comme un moyen de compenser pour ces stages non-payés, on s’offusque du travail du sexe, plutôt que de la précarité des étudiant.e.s. Dans le même temps, les femmes sont supposées étudier pour acquérir l’indépendance économique que peut permettre un emploi qualifié, et déjà disposer des ressources leur permettant de gagner leur vie durant ce temps de travail non-rémunéré. La condition de réalisation de ces stages non-payés est donc la dépendance des stagiaires à un.e conjoint.e, une famille, ou des patron.ne.s qui leur fournissent ces ressources. La volonté de préserver ce système de stages non-payés apparaît inséparable de la volonté de préserver cette dépendance des stagiaires (et notamment, des stagiaires femmes), une dépendance qui a bien souvent son lot d’exploitation, de harcèlement et de violences.
LA GRATUITE, TOUJOURS UNE «ZONE À DÉFENDRE» ?
Loin d’être la condition permettant à certaines activités d’échapper aux dynamiques d’aliénation que l’on retrouve dans les sphères marchandes, la gratuité apparaît donc, dans l’économie capitaliste, à la fois comme la condition et le prolongement de la sphère (officiellement) marchande. Plus précisément, et pour reprendre les mots de Maud Simonet dans son récent ouvrage consacré au travail gratuit, celui-ci « s’inscrit donc à double-titre dans les brèches de l’emploi » dans la mesure où « il maintient la croyance dans le fonctionnement du marché du travail, et participe ainsi largement à reproduire le système tel qu’il est [5]».
Malgré ce contexte, il apparaît que certain.e.s professeur.e.s notamment continuent de s’opposer à la mise en place d’un salaire étudiant. Sandrine Belley, Annabelle Berthiaume et Valérie Simard qualifient cette tendance « à évacuer toute critique à l’égard du mécanisme de reproduction sociale que constitue l’éducation » de « rapport nostalgique à l’institution scolaire »[6]. De la même manière, on peut qualifier, sinon de nostalgique, ou du moins d’idéaliste, le rapport de certaines féministes au travail du sexe lorsqu’elles présentent le désir et la gratuité de la sexualité comme condition de non-aliénation de celle-ci. La thèse partagée par bien des militant.e.s contre la reconnaissance du travail du sexe comme travail postule que dans la mesure où le rapport prostitutionnel ne découlerait pas d'un désir réciproque entre les individus impliqués, puisque la condition de sa réalisation est la rémunération de l’un.e des partenaires par l’autre, il s’inscrirait dans le continuum des violences sexuelles. D’un côté, désir, gratuité et « zone à défendre », de l’autre, rémunération, violence et marchandisation. Les féministes matérialistes et marxistes ont pourtant bien montré que ce n’était pas la « nature » d’une activité qui détermine combien elle sera rémunérée, mais bien la situation de l’activité dans les rapports de production capitaliste. De là, il n’y a aucune raison de considérer que la non rémunération d’une activité garantit qu’elle échappe aux rapports capitalistes.
« L'AMOUR NE PAIE PAS LES FACTURES »[7]
De même que le mythe de l’amour romantique[8] a servi depuis des siècles à extorquer le travail domestique et sexuel des femmes, le mythe néolibéral de l’épanouissement dans son travail sert à l’extorsion du travail productif. La persistance de ces mythes tient beaucoup à l’idée qu’il serait illégitime de la part des personnes extorquées de réclamer davantage que ce que cette extorsion est supposée leur apporter : aux unes, la satisfaction personnelle d’être une vraie fée du logis, et éventuellement du plaisir sexuel, aux autres, une formation professionnelle. Si le dévouement féminin fut longtemps glorifié[9], la réappropriation de certains progrès des luttes féministes par l’idéologie néolibérale de l’épanouissement personnel promeut l’idée qu’il ne s’agit plus, pour les femmes, de se sacrifier dans le travail domestique et sexuel, mais de trouver son plaisir dans ces activités, d’en faire ce qui répond à notre désir.
Dans un article consacré à l’émancipation, l’historienne féministe Joan Scott, dénonçant certains discours qui stigmatisent les femmes musulmanes supposées sexuellement opprimées de par leur religion, écrit que : « l’accent placé sur une sexualité libérée (qu’elle soit hétéro ou homosexuelle) fait écho au désir de consommer qui sert de moteur au marché, et permet de détourner l’attention des injustices économiques et sociales qui résultent de la discrimination et des formes structurelles de l’inégalité [10]». Autrement dit, dans un contexte néolibéral, la reconnaissance des femmes comme sujets permise par les luttes féministes devient principalement la reconnaissance d’une subjectivité capable d’agir selon ses désirs, sans s’interroger sur les conditions de production de ces désirs, ni sur les conditions permettant de les satisfaire. Au-delà de la sexualité, on pourrait également évoquer la question de la maternité : si elle répond à un désir d’enfanter, alors sa gratification se retrouverait dans sa réalisation-même. Or, en dépit du bonheur certain qu’elle peut apporter, la maternité s’accompagne également, dans nos sociétés, de violences médicales et de surmenages : on reconnaît la somme de travail qu’implique la maternité lorsqu’il s’agit, à bien peu de frais, de rappeler que nos mères sont des héroïnes, mais on l’oublie dès lors qu’il s’agit de punir exemplairement celle qui exprime radicalement et violemment son refus du travail par l’infanticide. Peu importe que la sexualité hétérosexuelle soit en grande majorité insatisfaisante pour les femmes, tant sur le plan physique qu’émotionnel : à défaut d’en tirer une satisfaction monétaire qui nous exposera au stigmate soit de femme vénale et de pute, soit de victime suprême qui ne saurait trouver d’autre satisfaction dans le sexe, le nouveau marché du viagra féminin permet désormais de venir réparer notre manque de désir[11].
Si ces éléments de réflexion peuvent sembler anecdotiques, ils nous rappellent que des expériences aussi intimes, et que l’on aimerait aussi étanches que possibles à la sphère marchande, que la maternité et le sexe, sont déterminées par l’organisation capitaliste de la société. Dans ce contexte, il est au mieux naïf de penser que l’université, l’entreprise ou les institutions, pourraient aujourd’hui constituer de véritables « zones de gratuité » non déterminées par leur situation dans une société néolibérale, et que c’est la rémunération d’activités jusqu’ici effectuées gratuitement qui ouvrirait la porte à la marchandisation de ces secteurs et à l’aliénation de celles et ceux qui y travaillent. La porte de l’université leur est déjà grande ouverte : il s’agit donc désormais de les accueillir comme il se doit, en donnant aux étudiant.e.s les moyens adéquats de se défendre.
Gary Assouline, « Le camion "Sugar Daddy" accusé d'encourager la prostitution étudiante a été saisi », Huffington Post, 26 novembre 2017, https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/26/le-camion-sugar-daddy-accuse-dencourager-la-prostitution-etudiante-a-ete-saisi_a_23257057/ ↩︎
Fédération des Associations Générales Etudiantes, Prostitution étudiante, la FAGE poursuit en justice une plateforme de rencontres, 25 novembre 2017, https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2017-10-25,fage-prostitution-etudiante-la-fage-poursuit-en-justice-une-plateforme-de-rencontres.htm ↩︎
Observatoire des inégalités, La pauvreté augmente chez les plus jeunes, mais n’épargne pas les plus âgés, 15 mai 2018, https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages ↩︎
Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, Article 18 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396046&categorieLien=id ↩︎
Maud Simonet, Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? Textuel, 2018, p. 138-139. ↩︎
Sandrine Belley, Annabelle Berthiaume, Valérie Simard, « L’exploitation n’est pas une vocation ! Pour la rémunération des stages et la fin du travail étudiant gratuit », in Camille Robert, Louise Toupin (dir.), Travail invisible. Portraits d'une lutte féministe inachevée, Montréal, Remue-ménage, 2018, p. 151. ↩︎
Slogan notamment utilisé par des militantes de la campagne Wages for Housework lors de la marche pour la journée internationale des femmes à New York en 1977. J.C. Pan, « Love’s Labor Earned », Dissent Magazine, Winter 2017, https://www.dissentmagazine.org/article/loves-labor-earned ↩︎
Voir Giovanna Franca Dalla Costa, The Work of Love: Unpaid Housework, Poverty and Sexual Violence at the Dawn of the 21st Century, Autonomedia, 2006. ↩︎
Véronique Cloutier et Camille Tremblay-Fournier, « Rémunération : la fin du dévouement ? », CUTE Magazine, Automne 2018, https://dissident.es/remuneration-la-fin-du-devouement/ ↩︎
Joan W. Scott, « Émancipation et égalité : une généalogie critique », Contretemps, mars 2014, https://www.contretemps.eu/emancipation-et-egalite-une-genealogie-critique/ ↩︎
« FDA approves 'Female Viagra' pill to increase sex drive », USA Today, 18 août 2015, https://eu.usatoday.com/story/news/health/2015/08/18/fda-approves-female-viagra-pill-increase-sex-drive/31952769/ ↩︎
Cet article a été publié dans le numéro de l'hiver 2019 du CUTE Magazine. Pour te tenir informé.e sur la lutte pour la pleine reconnaissance du travail étudiant, pour en discuter ou pour y contribuer, tu peux nous contacter via la page CUTE Campagne sur le travail étudiant.