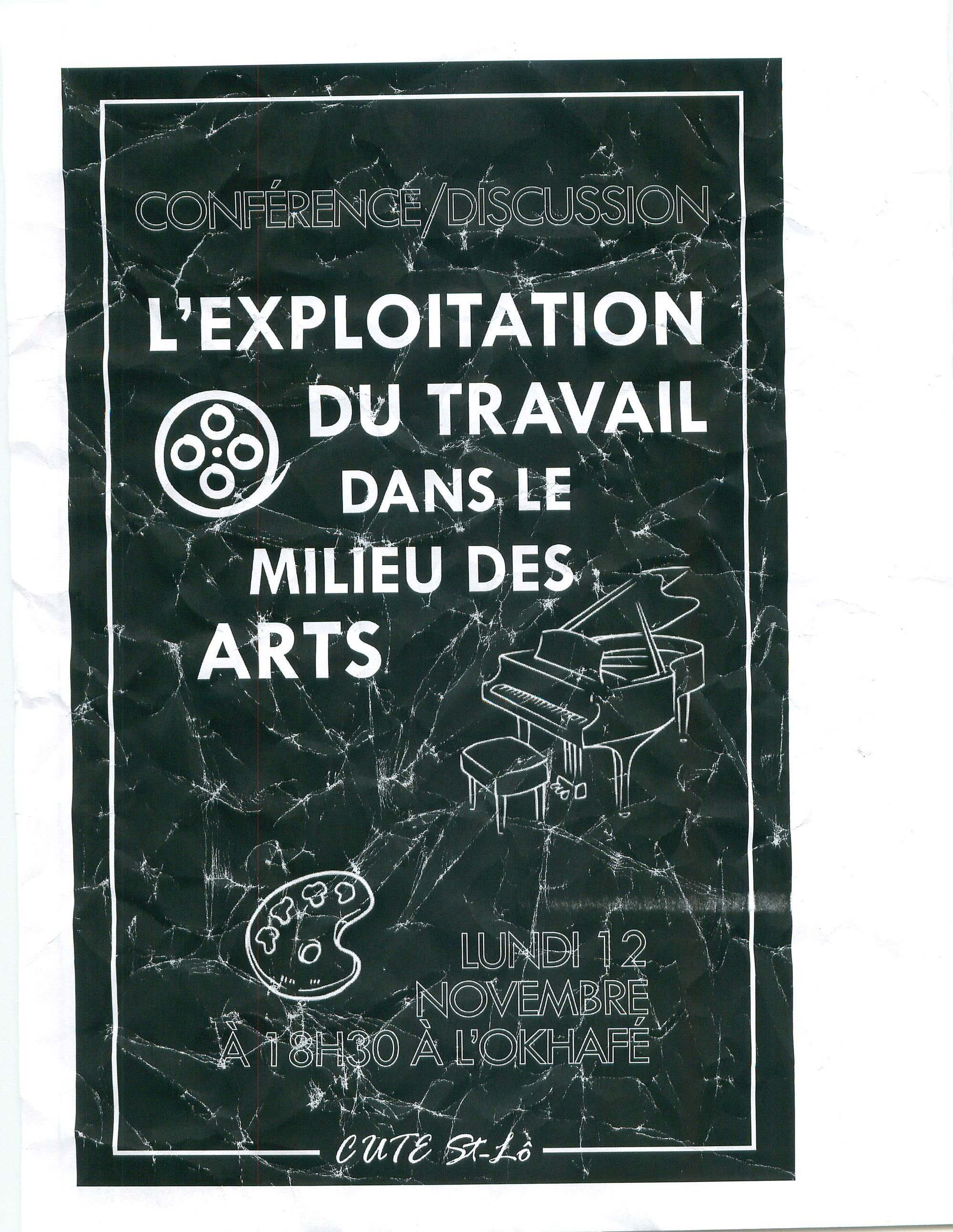Par Virginie Jourdain, artiste, commissaire d’expositions et travailleuse culturelle féministe
Mon premier travail gratuit en art, c'était à 17 ans.
Aujourd'hui j'en ai 38. J’ai expérimenté récemment ce qu’était le burn out.
J'avais vécu le chômage de ma mère; j'ai été marquée par son stress et sa peur de la précarité durant mon enfance. Elle nous a élevées, moi et ma soeur, dans la valeur du « travail ». Pas celle qui va t'épanouir, mais celle qui équivaut à une lutte perpétuelle, où tu n’as clairement pas les mêmes armes que tes employeur.e.s pour défendre tes droits. Je savais que ce qui m'attendait ce n’était pas une partie de plaisir. Je me suis ainsi toujours méfiée des patron.ne.s et des riches (merci maman) et je déteste celles et ceux qui aspirent à le devenir.
Par ailleurs, j'ai joué sagement le jeu de la carrière en culture qui consiste progressivement à se faire sa « place ». Venant d'une famille sans aucun réseau dans le milieu culturel, je n'ai pas eu le choix de prendre le chemin stratégique du « travail gratuit ». J'ai travaillé bénévolement pour faire des montages d'expositions et de « l'accueil du public », qui équivaut à faire la job d'une caméra de surveillance dans la plupart du temps. Très rapidement, j'ai compris que les ordres me seront donnés principalement par des hommes, et ce, pour un bon bout de temps. Il a fallu, par exemple, que je prouve que j'étais capable d'utiliser mes bras et de gérer des oeuvres lourdes, ou d’utiliser des outils et mon cerveau. Je n'avais par contre pas le droit à l'erreur.
J'ai dû apprendre à côtoyer un milieu qui ne me ressemblait pas du tout. J'étais gouine, c'était clairement visible. Dans une foire d'art contemporain, une gouine c'est un peu vécu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
En travaillant bénévolement, avec acharnement, j'ai fait les premières lignes de mon C.V. J'ai eu accès aux Écoles d'arts et à l'Université. Ayant été docilement formatée, je me souviens avoir même portée une jupe au vernissage de l'exposition de fin d'études de mon Master, ce que je ne fais jamais. Des années plus tard, j'ai enfin réussi à travailler en art sans avoir (autant) le sentiment de trahir mes convictions politiques. Être de gauche et graviter dans le monde de l'art, ça donne souvent envie de vomir. J'ai cumulé des stages pour boucler ma formation universitaire, j'ai travaillé dans des grandes villes, je l’ai fait gratuitement ou quasiment et j'ai vécu pendant de longs mois sur les canapés de mes ami.e.s. J’étais serveuse pour ramasser du cash, là aussi c'était jupe obligatoire (et oui au 21ème siècle).
L’IMPOSTEURE ET LA FLÛTE DE CHAMPAGNE
La communauté féministe m'a sauvé dans ma vingtaine. La découverte de tout un pan de la culture queer et féministe m'a donné de l'énergie et beaucoup d'amour pour développer des événements hors des institutions dans lesquelles je me sentais imposteurE. En plus d'imposteurE prolo ET de région, j'étais imposteurE gouine, ça fait beaucoup pour pouvoir manger des petites bouchées dans les vernissages avec le sourire. On a toujours peur que ça se voit (et ça se voit).
Gouine rurale prolo, de la bouse sur les tapis rouges… c’était un peu ça mon feeling et je l’ai toujours en arrière de la tête, ce sentiment quand je serre la main à des messieurs prestigieux à cravate, directeurs de centres d’art.
J'ai compris très tardivement le rapport à la classe sociale dans le milieu de l'art et comment les pions se répartissaient réellement. Comment nous incorporons ce rapport de classe quoi que nous fassions. J'ai réalisé que ma communauté d'artistes, de chercheuses, d’enseignantes et d’autres travailleuses culturelles féministes était loin d'être diversifiée à tous points de vue, et ce aussi en terme de classe sociale. J'ai réalisé aussi que si j'avais une place dans la gang des pro-féministes en art, qui en gagnent leur vie, je n'aurais jamais certains codes. Les codes qui font que tu as l'assurance nécessaire de négocier ton salaire, que tu es complètement à l'aise de postuler pour des emplois à hautes responsabilités, tu ne les as pas et tu ne les auras jamais, parce que tu n’as pas baigné là-dedans toute petite. Baigner dans le sentiment d’être légitime tout le temps et partout, le sentiment que tout est possible parce que tu es valorisée dès le berceau.
J'ai compris que le travail gratuit et la précarité pour gravir les échelons et « faire sa place » à coup de pioches dans la pierre, ça n'était pas la réalité de tout le monde. J'ai compris que le travail gratuit en art comme ailleurs, c'est la cerise sur le Sunday du libéralisme. Ça filtre les plus vulnérables et ça répartit les cartes.
Qui peut travailler gratuitement et payer son loyer ? Qui peut faire du réseautage tous les soirs? Qui peut passer ses journées dans son atelier ? Qui peut partir en résidence d’artiste durant des mois à l’autre bout du monde ? … pas les précaires.
Bonne réponse !
SE SERRER LES COUDES - POUSSER DES COUDES
Presque 20 ans plus tard, je me rends compte que la bataille n'est jamais finie. Que les alliances féministes sont très dures à maintenir dans le milieu de l'art. Si les riches se tiennent et sont solidaires dans leurs réseaux bien ficelés, ça n’est pas forcément le cas pour les autres et ça n’est pas un hasard. Un milieu professionnel où les places sont rares et les personnes ont soif de reconnaissance (ou de pouvoir) ça n’est pas forcément le plus safe des contextes. On peut parfois constater que l’ambition de carrière équivaut parfois à pousser des coudes sans état d'âme pour faire son chemin, quitte à broyer du monde au passage, et ce, dans toutes les structures et organismes. Une des conséquences à cette réalité est que la communauté féministe et artistique, dans laquelle je gravite, est épuisée et que tout le monde a peur de perdre sa « place » ou d’éventuelles opportunités, tout en manquant clairement parfois de cohérence politique.
Le travail gratuit et la précarité nous ont passé.e.s dessus comme un train de marchandises. À cela s'ajoute forcément des guerres intestines où se mêlent traumas, pouvoirs, affects mélangés à la sauce politique anti-oppression, ça donne une belle bombe qui nous explose à la face les un.e.s après les autres. Nous sommes épuisé.e.s et nous nous déchirons.
Si tu tombes, too bad.
Pendant ce temps là, comme le mentionne Jack Halberstam dans son article « Tu me fais violence » [1], le capitalisme fait son travail en toute quiétude en nous regardant avec jubilation nous tirer dans les pattes: « Est-ce cela, la fin du monde ? Quand des groupes de personnes qui partagent une cause, des rêves utopiques et un même but se condamnent entre elles au lieu d’anéantir les banques et les banquiers, les politiciens et les parlements, les présidents d’université et les PDG ? (...) nous décidons des mesures disciplinaires, nous nous évinçons les un.e.s les autres de projets qui devraient nous unir, et nous nous réunissons en petits réseaux érotiques pétris d’autosatisfaction. »
Le travail gratuit, qu’il soit émotionnel ou militant, s'entremêle à la réalité des conditions de travail de l'art pour certain.e.s d'entre nous. Nous sommes fatigué.e.s et nous sommes loin d'être à égalité dans la lutte à la survie économique et sociale.
« ET TES PROJETS ? TU TRAVAILLES SUR QUOI EN CE MOMENT ? »
D’ailleurs, je souhaite adresser un mot au passage à ma communauté artistique à propos de cette fatigue, cet épuisement.
La coutume qui prévaut dans le milieu est de demander :
-« Alors toi tes projets, tu en es où ? Tu travailles sur quoi en ce moment ? »
Il faut arrêter ça.
Comme il faut arrêter de répondre le torse bombé :
-« Je travaille sur plein de projets et je suis débordée, c'est le fun. »
Parce que parfois ça cache un :
-« En ce moment, bah je passe ma journée en boule, j’avale des anti-dépresseurs le soir et je peux que lire du Agatha Christie et manger du mou. »
Cette communauté qui dénonce les méfaits du néolibéralisme se vante en même temps d’être débordée et en surcharge de travail, ce qui s'avérerait être une preuve de réussite de carrière artistique. Comme si le débordement de travail était un gage de crédibilité ou bien d’une pratique de qualité. Il y a des réalités qui font que tu es broyée et cassée par ton travail. Les causes peuvent être multiples, un accident, une dépression, un burn out ou du harcèlement. Faire le paon avec sa biographie à chaque interaction sociale, cela va pourtant à l'encontre des convictions progressistes dont le milieu artistique se prétend être généralement l’étendard et des valeurs de solidarité et de caring défendues par la communauté féministe. On fait quoi des personnes fatiguées, brûlées, cassées par le travail de l’art ? C’est le temps d’ouvrir une discussion collective sur ce tabou et de donner des espaces de reconnaissance, de paroles et de réparation pour ces personnes.
Si être rémunéré.e est un droit fondamental pour lequel il faut se battre, il est urgent également de prendre le temps nécessaire pour évaluer collectivement notre rapport au travail, à la structuration des institutions et à la répartition des rôles, des responsabilités, en tant qu’artiste ainsi que travailleuse et travailleur culturel.le et militant.e. C’est pour cela que voir s’organiser un mouvement contre les stages gratuits en art est une excellente nouvelle; la lutte contre les stages gratuits va participer pleinement à une prise de conscience absolument nécessaire du milieu.
Jack Halberstam, « Tu me fais violence ! » La rhétorique néolibérale de la blessure, du danger et du traumatisme, traduit de l’anglais par Clémence Garrot et Suzanne Renard, Vacarme, 2015/3 (N° 72), p.28 -41. ↩︎
Cet article a été publié dans le numéro de l'hiver 2019 du CUTE Magazine. Pour te tenir informé.e sur la lutte pour la pleine reconnaissance du travail étudiant, pour en discuter ou pour y contribuer, tu peux nous contacter via la page CUTE Campagne sur le travail étudiant.